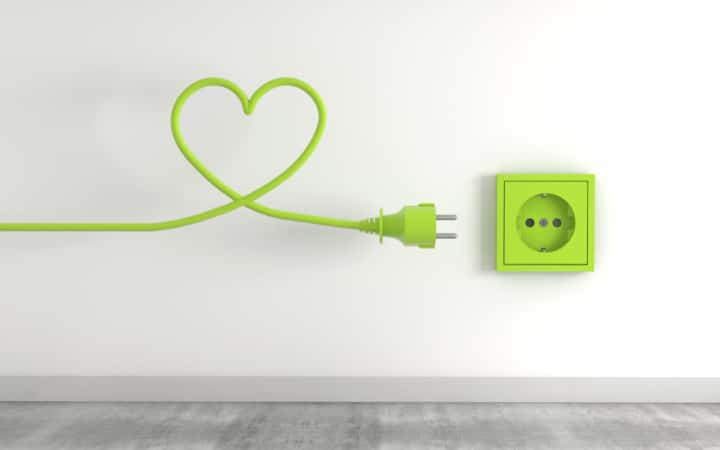Dans le cadre de la transition énergétique, la France joue un rôle essentiel, visant à remodeler son mix électrique. En 2023, les énergies renouvelables ont marqué leur importance en constituant environ 23% de la production électrique nationale, grâce à l’éolien, le solaire, l’hydraulique et la biomasse. Cette progression illustre un pas vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la dépendance aux combustibles fossiles.
Le gouvernement a pour objectif d’augmenter cette part à 40% d’ici 2030, affirmant son engagement pour un avenir énergétique durable. Cet article met en lumière l’évolution et les défis de l’intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique français.
Fournisseurs alternatifs d’électricité
Le marché français de l’électricité verte est à la fois dynamique et varié, avec une large palette de fournisseurs alternatifs qui mettent en avant des offres à la fois innovantes et respectueuses de l’environnement. Parmi ces acteurs, nous retrouvons des entreprises bien établies telles que ENGIE, TotalEnergies, Eni, Vattenfall, ainsi que des arrivants plus récents comme OHM Énergie, Mint Energie, ekWateur, et Enercoop.
Des nouveaux venus sur le marché, tels que Mint Energie et OHM Energie, attirent l’attention avec des offres compétitives et des remises séduisantes par rapport au tarif réglementé.
ENGIE et TotalEnergies se démarquent notamment par leurs offres d’électricité verte, assorties de garanties d’origine attestant de leur provenance renouvelable. Par exemple, TotalEnergies propose l’offre « Verte Fixe », garantissant une électricité 100% verte et française, tandis qu’ENGIE propose des plans tels que « Élec Tranquillité », avec des garanties similaires.
Certains fournisseurs, comme Enercoop et ekWateur, se distinguent par leur engagement envers la production locale d’électricité verte. Enercoop se positionne particulièrement sur la production locale et une gouvernance partagée, offrant une option à la fois solidaire et durable.
En proposant une alternative aux sources traditionnelles, ces fournisseurs alternatifs d’électricité jouent un rôle essentiel dans la promotion des énergies renouvelables, offrant aux consommateurs un éventail de choix pour participer activement à la transition énergétique en France.
État des lieux général du mix électrique français
Historique de la production électrique en France
Le mix électrique français, riche d’une histoire marquée par des choix stratégiques importants, a vu le nucléaire prendre une place prépondérante dès les années 1970 et 1980, notamment suite au choc pétrolier de 1973. Le plan Messmer, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, a propulsé le développement nucléaire, amenant cette source d’énergie à représenter jusqu’à 75% de l’énergie primaire pour la production d’électricité en 1990.
Avant cette période, l’hydraulique avait joué un rôle significatif, surtout après la Seconde Guerre mondiale. La nationalisation de l’électricité en 1946 et un plan favorable à l’hydraulique ont permis à cette énergie de couvrir jusqu’à 60% de la production électrique entre 1946 et 1960.
Aujourd’hui, bien que le nucléaire domine, la France s’oriente vers une diversification de son mix énergétique avec une augmentation des énergies renouvelables, en ligne avec les objectifs de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Montée en puissance des énergies renouvelables
La transition énergétique en France a franchi plusieurs étapes clés, avec les lois Grenelle de l’environnement de 2009 et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) établissant des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables. Ces initiatives visent à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à augmenter la part des renouvelables dans le mix énergétique.
Les filières éolienne, solaire, et biomasse ont vu leur croissance s’accélérer récemment. En 2023, la production d’électricité éolienne et solaire a respectivement dépassé les 30 TWh et les 15 TWh. La biomasse a, quant à elle, contribué à hauteur d’environ 7 TWh.
Les données récentes de RTE (Réseau de Transport d’Électricité) France indiquent une tendance positive pour les énergies renouvelables. En 2024, la production hydraulique a atteint un record de 68,2 TWh, tandis que l’éolien et le solaire poursuivaient leur croissance.
Chiffres clés de la part des renouvelables
En 2023, les énergies renouvelables représentaient environ 23% de la production d’électricité en France, une distinction faite entre la production brute et la couverture de la demande. La production brute réfère à toute l’électricité issue des sources renouvelables, tandis que la couverture de la demande considère la consommation finale brute d’électricité.
Comparée à d’autres pays européens, la France occupe une position intermédiaire. Bien que des nations comme l’Allemagne ou le Danemark affichent une part plus conséquente d’énergies renouvelables dans leur mix énergétique, la France progresse vers les objectifs de l’Union européenne en matière de transition énergétique.
Ces données soulignent l’engagement de la France dans la transition vers un mix énergétique plus vert et durable, tout en mettant en lumière les défis et opportunités de cette transformation.
Chiffres clés de la part des renouvelables
Hydroélectricité
L’hydroélectricité, pionnière des énergies renouvelables en France, tire profit de barrages, stations de pompage et microcentrales pour produire de l’électricité. Elle se distingue par sa flexibilité et sa capacité à stocker de l’énergie. Toutefois, elle est tributaire des précipitations et des ressources en eau, et pose des défis environnementaux, notamment en ce qui concerne les écosystèmes aquatiques.
En 2023, l’hydroélectricité a fourni environ 68 TWh d’électricité en France, marquant une contribution importante au mix énergétique renouvelable du pays.
Éolien (terrestre et offshore)
L’éolien, à la fois terrestre et offshore, a notablement progressé, avec des développements sur l’ensemble du territoire et les premiers parcs offshore comme celui de Saint-Nazaire. Ces installations, atteignant une puissance d’environ 1,4 GW, peuvent alimenter près de 2 millions de foyers. Malgré son coût marginal faible et une technologie éprouvée, l’éolien fait face à des défis d’acceptabilité sociale et d’intermittence de production.
Solaire photovoltaïque
Le solaire photovoltaïque a vu sa croissance s’accélérer, soutenue par la réduction des coûts des panneaux solaires et des incitations fiscales. En 2023, il a produit plus de 15 TWh, principalement via des installations sur toitures résidentielles et des centrales au sol. Cependant, l’intermittence de la production et la nécessité de solutions de stockage demeurent des défis majeurs.
Biomasse et bioénergies
La biomasse et les bioénergies ont aussi connu une croissance, avec une production dépassant les 7 TWh en 2023. Cette filière tire parti d’une grande diversité de sources, mais doit naviguer entre la compétition pour l’utilisation de la biomasse et les préoccupations environnementales liées à sa production et transformation.
Énergies marines et géothermie
Les énergies marines, incluant l’hydrolienne et la marémotrice, se trouvent actuellement en phase expérimentale, mais elles révèlent un potentiel significatif pour un développement à moyen et long terme. Ces technologies ambitionnent de capter l’énergie générée par les courants marins et les marées afin de produire de l’électricité. Parallèlement, la géothermie, exploitée tant à haute qu’à basse température, offre des perspectives encourageantes, particulièrement pour le chauffage et la production d’électricité, même si son essor reste pour l’instant modeste en France.
Ces secteurs, bien qu’encore moins développés que l’hydroélectricité, l’éolien ou le solaire, constituent une composante essentielle pour la diversification du mix énergétique renouvelable en France. Ils promettent des opportunités de croissance et d’innovation significatives pour les années à venir.

Facteurs de progression et enjeux d’acceptabilité
Cadre réglementaire et soutiens publics
Le cadre réglementaire et les soutiens publics sont déterminants dans l’avancement des énergies renouvelables en France. La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) établissent des objectifs ambitieux pour l’essor des énergies renouvelables, avec un but de 32% de la consommation d’énergie provenant de sources renouvelables d’ici 2030. À cet égard, le bilan français en 2023 montre que des progrès significatifs ont été réalisés, malgré la nécessité d’accélérer encore le rythme pour atteindre les objectifs fixés.
Les mécanismes de soutien comprennent des tarifs d’achat garantis, des appels d’offres pour les grands projets, et des exonérations fiscales, favorisant l’investissement dans les énergies renouvelables. La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) renforce ces mesures en proposant des plans d’action pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et encourager l’efficacité énergétique.
Acceptabilité sociale et concertation locale
L’acceptabilité sociale des projets d’énergies renouvelables représente un défi significatif. Les projets comme les parcs éoliens ou les installations photovoltaïques au sol peuvent susciter de l’opposition locale, souvent motivée par des inquiétudes esthétiques, environnementales ou de santé publique. Toutefois, la mise en valeur des retombées économiques locales peut grandement améliorer l’adhésion des communautés.
Les collectivités et les citoyens ont un rôle essentiel dans ce processus d’acceptabilité. Les initiatives participatives et les coopératives locales engagent les acteurs locaux et distribuent les bénéfices économiques des projets, améliorant ainsi l’acceptabilité sociale. Les coopératives d’énergie renouvelable, par exemple, offrent aux citoyens l’opportunité de devenir actionnaires des projets et de profiter directement des revenus générés.
Innovation et recherche
L’innovation et la recherche sont essentielles pour relever les défis techniques et économiques des énergies renouvelables. Des technologies avancées telles que l’éolien flottant, les nouvelles générations de panneaux solaires, et les solutions de stockage d’énergie (batteries, hydrogène) sont en cours de développement.
Ces progrès technologiques visent à pallier l’intermittence de la production et à augmenter la flexibilité des systèmes énergétiques. Les défis liés à l’intermittence sont abordés grâce à des solutions de flexibilité, comme le pilotage intelligent de la demande, l’utilisation de batteries et de l’hydrogène. Le programme des Investissements d’Avenir (PIA) et l’initiative Mission Innovation appuient ces efforts de recherche et développement, en finançant des projets novateurs et en favorisant la coopération internationale sur les innovations bas carbone.
Ces avancées et soutiens sont vitaux pour accélérer la transition énergétique en France et atteindre les objectifs de la LTECV et de la PPE.
Analyse des chiffres 2023 / 2024 : tendances et perspectives
Production et couverture de la consommation
Les énergies renouvelables ont franchi un cap majeur en France, assurant plus de 30% de la consommation électrique totale en 2024. D’après Enedis, cette progression est principalement portée par le développement solaire et éolien. La production d’électricité verte a ainsi grimpé à 148 TWh en 2024, marquant une augmentation de 6,5% par rapport à 139 TWh en 2023.
Le secteur solaire s’est particulièrement distingué, avec environ 4,5 GW de nouvelles capacités installées en 2024, quadruplant le taux de croissance annuel des dernières années. L’énergie éolienne, incluant les installations terrestres et maritimes, a aussi vu une croissance soutenue, quoique moins rapide que celle du solaire. Parallèlement, la production nucléaire a montré des signes de stabilisation ou de léger recul, soulignant la transition vers un mix énergétique plus diversifié et écologique.
Records récents et objectifs futurs
Les records atteints récemment en matière de capacités renouvelables installées sont un signe prometteur. En 2024, la France a intégré 6 GW de capacités renouvelables supplémentaires, portant le total à plus de 78 GW.
Cette avancée s’aligne sur les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), qui visent 32% de consommation d’énergie renouvelable d’ici 2030. Ces ambitions s’inscrivent également dans le cadre des objectifs européens, poussant la France à contribuer significativement à l’accélération de la transition énergétique. Les révisions récentes des cibles européennes pourraient requérir des efforts encore plus conséquents, renforçant l’impératif de poursuivre et d’intensifier le développement des énergies vertes.
Comparaisons internationales
Sur le plan international, la position de la France dans le développement des énergies renouvelables est nuancée. Bien que l’Allemagne et l’Espagne soient souvent perçues comme des précurseurs, la France avance prudemment, se classant généralement entre la 10e et la 14e place parmi une vingtaine de pays européens selon Greenpeace, surtout en ce qui concerne le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre.
Toutefois, le mix énergétique français, caractérisé par une forte présence de l’hydroélectricité et du nucléaire, offre un contexte unique. La France doit donc trouver un équilibre entre la réalisation de ses objectifs de transition énergétique et l’optimisation de ses ressources existantes, tout en se conformant aux ambitions européennes et internationales pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Défis de la transition vers un mix plus vert
Stockage de l’énergie et gestion de l’intermittence
La transition vers un mix énergétique plus vert fait face à des défis majeurs, parmi lesquels la gestion de l’intermittence des énergies renouvelables se distingue. L’énergie éolienne et solaire photovoltaïque, par exemple, est soumise à des variations en fonction du climat. Pour surmonter cette difficulté, il est essentiel de développer des solutions de stockage d’énergie.
Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) représentent une solution clé pour emmagasiner l’énergie excédentaire durant les périodes de basse consommation. Les batteries, en particulier les batteries lithium-ion, jouent un rôle essentiel dans la stabilisation du réseau électrique.
L’hydrogène vert, généré à partir d’électricité renouvelable, émerge comme une option prometteuse pour le stockage et la conversion de l’énergie.
La flexibilité est essentielle pour maintenir la stabilité du réseau, une priorité pour les opérateurs tels que RTE (Réseau de Transport d’Électricité) et Enedis, qui s’efforcent d’intégrer ces solutions pour assurer un équilibre constant entre offre et demande d’électricité, même en périodes de production inégale.
Sécurisation d’approvisionnement et souveraineté énergétique
La dépendance à l’égard des importations de composants essentiels pour les technologies renouvelables, comme les terres rares pour les éoliennes ou les panneaux solaires, pose un défi notable. Cette dépendance peut menacer la souveraineté énergétique de la France et accroître les risques de perturbations dans l’approvisionnement.
Face à ce défi, la France développe une stratégie industrielle visant à établir des filières nationales compétitives. Le plan France 2030 alloue des fonds pour encourager l’innovation et renforcer l’offre nationale dans le domaine des énergies renouvelables, réduisant ainsi la dépendance aux importations et augmentant la résilience de l’économie française aux fluctuations du marché mondial.
Coûts et financements
La transition énergétique exige d’importants investissements dans les infrastructures, la recherche et le développement (R&D), ainsi que dans la modernisation des réseaux électriques. Selon un rapport de l’Inspection générale des finances, les collectivités territoriales devront investir environ 21 milliards d’euros annuellement d’ici 2030 pour mener à bien la transition écologique.
Ces investissements, bien qu’impactant initialement les tarifs pour les consommateurs, génèrent des retombées positives sur l’emploi et la croissance économique. La création de nouveaux emplois dans les secteurs de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique représente l’une des bénéfices notables. Par ailleurs, les économies réalisées grâce à la diminution de la consommation énergétique et à l’adoption des énergies renouvelables peuvent compenser une partie des coûts initiaux.
Perspectives
Synthèse de la situation
La France constate une progression constante des énergies renouvelables dans sa production électrique, bien qu’elle doive encore parcourir un long chemin pour atteindre les objectifs de 2030 et 2050. En 2023, ces énergies ont constitué près de 30% de la production totale, soit 139 TWh, incluant une part significative d’hydroélectricité.
Face à ces avancées, il est impératif que la France accélère son développement pour répondre aux ambitions fixées. La révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) a abaissé l’objectif à 35% d’énergies renouvelables dans la consommation électrique pour 2030, contre 40% auparavant, représentant ainsi un défi majeur.
La complémentarité entre les énergies renouvelables et le nucléaire joue un rôle essentiel. Alors que la France envisage d’augmenter le nombre de réacteurs EPR pour assurer une production d’électricité stable et faible en carbone, les énergies renouvelables doivent continuer leur progression pour réduire les émissions de CO₂.
Regards vers l’avenir
À l’horizon 2030 et 2050, la France se trouve face à des défis majeurs pour sa transition énergétique. L’instauration de politiques incitatives et de soutiens financiers pour les projets renouvelables est essentielle.
L’accélération du développement de l’éolien en mer, du solaire photovoltaïque, et de la biomasse est essentielle, tout en abordant les enjeux d’acceptabilité sociale et de gestion de l’intermittence.
Les études prospectives, comme celles de Greenpeace et de l’Ademe, indiquent que la France peut viser un mix énergétique 100% renouvelable d’ici 2050, en se concentrant sur la sobriété et l’efficacité énergétique et le développement des renouvelables. Ces scénarios mettent en avant la nécessité de réduire significativement la part du nucléaire et des énergies fossiles, tout en assurant la fiabilité et la stabilité du réseau électrique.
Enfin, la coopération internationale et les engagements de la France lors de la COP28 de Dubaï, promettant de tripler sa production d’énergie renouvelable d’ici 2030, sont des éléments clés pour réaliser ces objectifs ambitieux et lutter efficacement contre le changement climatique.
Conclusion
En conclusion, la France a réalisé des avancées notables dans son parcours vers la transition énergétique. Cependant, elle est confrontée à d’importants défis. Les énergies renouvelables, représentant 28% du mix électrique en 2023, doivent intensifier leur développement pour atteindre l’objectif ambitieux de 40% d’ici 2030.
La synergie entre le nucléaire et les sources renouvelables joue un rôle clé, tout comme la gestion de leur intermittence et le stockage de l’énergie.
Les enjeux de sécurité d’approvisionnement, de souveraineté énergétique, et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont essentiels. Pour naviguer avec succès dans cette transition, la France doit investir dans les infrastructures, la recherche et le développement, et promouvoir l’efficacité énergétique. L’engagement des citoyens, des collectivités et des entreprises est essentiel pour assurer une transition inclusive et durable.
En définitive, la transition énergétique représente une opportunité majeure pour le développement durable, l’innovation et la création d’emplois. Il est impératif de passer à l’action, de soutenir des politiques énergétiques ambitieuses et de s’impliquer activement dans la construction d’un futur énergétique plus vert et plus résilient.
FAQ
Quelle a été la production totale d’électricité en France en 2024, et comment se compare-t-elle aux années précédentes?
En 2024, la France a enregistré une production électrique totale de 536,5 TWh, marquant le niveau le plus élevé des cinq dernières années, équivalant ainsi à la moyenne des années 2014 à 2019. Cette hausse notable, par rapport aux 494 TWh de 2023, marque un retour au niveau de 2019, après une période de défis liés notamment à la corrosion sous contrainte des installations nucléaires et aux effets de la sécheresse sur la production hydroélectrique.
Quelle est la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en France en 2024, et quelles sont les principales sources de ces énergies renouvelables?
En 2023, les énergies renouvelables représentaient 30% du mix énergétique français. Bien que les données spécifiques pour 2024 ne soient pas disponibles, les principales sources d’énergies renouvelables en France demeurent l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la biomasse, et l’énergie géothermique.
Comment la production nucléaire et hydraulique a-t-elle contribué à la production d’électricité en France en 2024?
La production nucléaire a joué un rôle prépondérant en 2024, avec une contribution de 361,7 TWh, grâce à la fin des maintenances prolongées et à l’amélioration des conditions d’exploitation. Parallèlement, la production hydraulique a atteint un pic inédit depuis 2013, avec 74,7 TWh, représentant 13,9% de la production totale d’électricité en métropole.
Quels sont les impacts de la croissance des énergies renouvelables sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux énergies fossiles en France?
La montée en puissance des énergies renouvelables en France a un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur la diminution de la dépendance aux énergies fossiles. Les sources telles que l’éolien, le solaire, et l’hydraulique ne génèrent pas de polluants, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique.
Visant 33% d’énergie renouvelable dans son mix énergétique d’ici 2030, la France pourrait réduire de 60% le déficit de sa balance commerciale lié aux importations d’énergie d’ici 2035. Cette transition favorise également la production d’énergie locale, réduisant la dépendance aux importations fossiles et maîtrisant mieux la facture énergétique nationale.